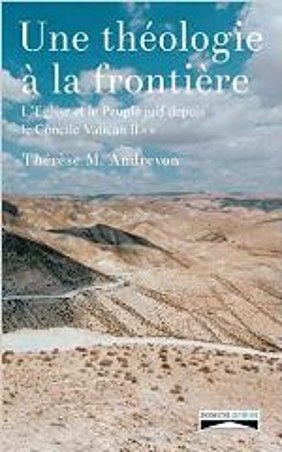Thérèse Martine Andrevon publie ici une version remaniée et mise à jour de la thèse de doctorat qu’elle a soutenue à l’Institut catholique de Paris en partenariat avec la Faculté de théologie de l’Université de Leuven en juin 2014. Le cardinal Kurt Koch note en préface que l’ouvrage «aborde de manière circonstanciée ce tournant de l’Église dans sa relation avec le judaïsme» que représente le paragraphe 4 de la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II (1965), tout en mettant en évidence «que l’élaboration d’une théologie catholique réellement cohérente sur le judaïsme nécessite un approfondissement ultérieur de la réflexion».
En introduction, T. M. Andrevon explique que le Concile a reconnu «la validité continuée de l’Ancienne Alliance» de Dieu avec le Peuple juif, renonçant ainsi à la théologie catholique traditionnelle selon laquelle l’Église se serait substituée à Israël. Dès lors, il devenait nécessaire d’élaborer une théologie catholique du judaïsme sur un autre modèle. Cinquante ans plus tard, où en sommes-nous, de quelles ressources dispose-t-on, et quels sont les chantiers à mettre en œuvre? Telles sont les questions auxquelles l’auteure veut répondre. Pour ce faire, elle propose, dit-elle, une vaste enquête historique et une analyse des textes magistériels sur les Juifs qu’elle met en rapport les uns avec les autres. Mais elle se soucie également d’explorer la préhistoire et de présenter les précurseurs de Nostra Aetate No 4 depuis le 19e s., de sonder les sources de ce texte, incluant les contributions du monde juif, d’en décrire le laborieux processus de rédaction, et d’analyser le contenu des documents officiels de l’Église qui en découlent ou qui s’y rapportent, y compris le récent texte de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme, «Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables» (10 décembre 2015).
Les résultats de ses recherches sont exposés en deux tomes, divisés chacun en deux parties. La première partie du tome 1 porte sur « la volte-face de l’enseignement catholique sur les Juifs» réalisée dans Nostra Aetate No 4, tandis que la seconde explore la préhistoire de ce texte et en présente les principaux précurseurs. La première partie du tome 2 décrit le kairos qui a favorisé l’émergence de la théologie catholique du judaïsme, soit la seconde guerre mondiale et l’annonce du Concile et la deuxième situe Nostra Aetate No 4 dans «l’œuvre conciliaire». Le sommaire complet de l’ouvrage est disponible sur le site de la maison d’édition (tome I et tome II).
Cette enquête est menée de façon méthodique et rigoureuse. Dans chaque cas, l’auteure présente en détails les documents étudiés, en faisant abondamment référence à la littérature secondaire qui les commente et en dressant un bilan des éléments positifs et négatifs, y semant ici et là plusieurs remarques personnelles qui alimenteront sa réflexion finale. L’essentiel de sa pensée se retrouve dans la conclusion générale où elle se livre à une «relecture critique du rôle programmatique de Nostra Aetate No 4 pour la théologie catholique du judaïsme», recense «les chantiers ouvert durant les cinquante dernières années», analyse «les points de résistance à cette théologie» et propose un essai de modèle théologique, une «piste pour conjuguer la validité de l’Alliance avec Israël et l’universalité du Salut en Christ».
Parmi les idées énoncées par l’auteure, principalement dans la conclusion, on retiendra par exemple cette formulation qui vise à conjuguer le statut d’Israël et la mission à l’universalité de l’Église: «Le judaïsme et le christianisme sont deux religions sœurs, nées l’une et l’autre des judaïsmes du second Temple, qui revendiquent l’une et l’autre une mission universelle pour le monde, mais au contenu différent. En effet, si l’Église a la mission d’annoncer le Salut aux nations, Israël témoigne du Dieu créateur, rédempteur et de l’élection qui est la manière dont Dieu aime. Israël ne prétend pas porter un message de Salut au monde, mais le Salut que Dieu accorde à son peuple a valeur de témoignage pour les nations » (t. 2, p. 355).
Un autre point original de la réflexion de M. T. Andrevon est sa «nouvelle approche de l’unité du Peuple de Dieu», constitué à la fois par Israël et par l’Église: «Nous formulons l’hypothèse que la Shoah puis le retour massif du Peuple juif sur la Terre d’Israël sur le mode d’une souveraineté nationale, ainsi que la transformation des rapports entre Israël et l’Église, inaugurent le rétablissement d’Israël prophétisé par Paul dans l’épître aux Romains. Ainsi, ayant repris une place sur la scène internationale et ecclésiale, le Peuple juif chemine maintenant avec l’Église en partenariat. La présence à ses côtés rend à celle-ci sa catholicité, d’une manière inattendue» ( t. 2, p. 383). Cette proposition, estime-t-elle, «honore l’Alliance d’Israël sans démentir la foi au Christ» (ibid.). Pour que l’unité finale de l’Église et d’Israël ait lieu, suggère M. T. Andrevon en conclusion, «il faut que l’Église ramène à Jérusalem ces ‘frères en offrande, de toutes les nations’ (Isaïe 66,20), c’est-à-dire que les successeurs des apôtres présentent aux Juifs les nations comme leurs frères, tandis que Jérusalem doit se convertir pour être une ville ouverte (Isaïe 60,11)» (p. 400). On peut se demander si cette lecture eschatologique de l’unité d’Israël et de l’Église n’assimile pas trop facilement le Peuple juif au seul État d’Israël. Ce sera vraisemlablement l’une de ces réflexions dont le cardinal Koch disait en préface qu’elles «seront à juste titre jugées controversées» (t. I, p. 9).
Cet ouvrage fouillé et touffu regorge d’informations précieuses et de réflexions stimulantes. Il est susceptible de générer d’intéressantes discussions théologiques entre les Juifs et les Chrétiens qui s’astreindront à en faire une lecture attentive. L’auteure rendrait également service au dialogue judéo-chrétien en produisant une version grand public succinte, peut-être un peu moins historique et un peu plus prospective, de sa proposition personnelle de théologie catholique du judaïsme «en rupture réelle avec la théologie de la substitution».