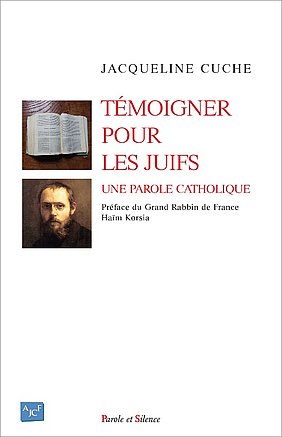Jacqueline Cuche, présidente fondatrice de l’Association Charles Péguy et présidente de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France de 2014 à 2020, explique en introduction que «Ce livre est né d’une nécessité: celle de transmettre un peu de ce que j’ai reçu durant tant d’années de mes amis juifs» (p. 9). Elle présente des conférences prononcées devant divers groupes et des articles rédigés pour des revues, dont Sens, la revue de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France. Les 14 textes du recueil sont regroupés en quatre parties, dont le fil conducteur, dit-elle, «suit tout simplement mon cheminement personnel, né de ma rencontre du judaïsme» (p. 9). Chaque partie s’ouvre par un préambule et comporte de deux à cinq chapitres de dimensions variables.
I. Les sources juives de la vie chrétienne
La première partie propose un repérage des traces du judaïsme dans la religion chrétienne, de manière à illustrer la richesse du «patrimoine spirituel commun» que les chrétiens partagent avec les juifs, selon l’expression de la déclaration conciliaire Nostra Aetate. À l’image de la racine, souvent utilisée pour parler des origines juives du christianisme, J. Cuche préfère celle de la source «qui évoque le flux de la vie» (p. 15). Les influences juives sur le christianisme lui paraissent particulièrement évidentes dans la prière chrétienne et dans la célébration de la Pâque, explorées tour à tour dans les deux chapitres de cette section.
S’agissant de la prière, l’auteure attire d’abord l’attention sur le Notre Père, enseigné par Jésus à ses disciples, et souligne ses affinités avec la prière quotidienne du Kaddish, enraciné dans une tradition juive ancienne. De leur côté, le rythme quotidien et le contenu de la prière des Heures, le cadre et le déroulement de la liturgie du dominicale (celle du «Jour du Seigneur»), sont apparentés à la prière et au culte du Temple de Jérusalem. Dans un court excursus, J. Cuche précise que l’ «accomplissement des Écritures» par Jésus, lors de la Cène notamment, ne signifie ni la dépréciation ni le remplacement de la Première Alliance, mais évoque plutôt l’idée de lui donner une «plénitude», comme le soulignait, dès 1948, Jules Isaac dans son Jésus et Israël (cité p. 23).
«Les principales fêtes chrétiennes s’inscrivent dans le cadre des fêtes juives, dont elles sont à la fois la continuité et l’accomplissement» (p. 27). C’est le cas, en particulier, de la vigile ou de la «veillée» pascale. Les rapprochements avec la tradition juive présentes dans ses diverses composantes liturgiques sont mises en évidence par J. Cuche qui s’arrête ensuite au terme «veillée». Elle le commente à partir d’Exode 12,42, où la Pâque juive est présentée à la fois comme une «nuit de veille pour le Seigneur» et une «nuit de veille pour tous les enfants d’Israël». Elle souligne aussi que le targum de l’Exode a associé à ce verset le «poème des quatre nuits», joignant à la Pâque trois autres grandes œuvres de salut: la première nuit de la création, celle de la ligature d’Isaac et celle de la venue du Messie (p. 37). L’attente de la rédemption, sur laquelle s’achève le séder pascal, trouve un écho dans l’espérance de la venue ultime du Christ, exprimée par les chrétiens lors de la veille pascale et au cours de chaque eucharistie.
II. Une lecture «dialogale» de la Bible
La deuxième partie veut mettre en évidence le lien qui unit le Nouveau Testament à l’Ancien et illustrer le «complément de sens» que la lecture chrétienne de la Bible tire d’un va et vient continu entre les deux Testaments (p. 43). Elle comporte cinq chapitres de longueur très variables.
«Quand Dieu visite son peuple» est une exploration assez rapide du thème de la «visite» de Dieu dans la Bible chrétienne. Dans l’Ancien Testament, où le terme hébreu paqad apparaît près de 300 fois, la visite de Dieu est souvent porteuse de salut. Mais Dieu vient aussi parfois examiner la conduite d’Israël ou des nations pour la sanctionner par un jugement. Dans le Nouveau Testament, le terme grec équivalent, beaucoup plus rare, ne désigne que cinq fois la visite de Dieu, dont quatre chez Luc, toujours dans un sens positif. Dieu visite son peuple, au sens plein du mot, «en la personne du Fils incarné» (p. 51). Dans la brève étude comparative qui clôt ce chapitre, J. Cuche dégage quelques points pertinent pour dialogue judéo-chrétien, soulignant notamment qu’il faut «se garder d’opposer comme on l’a fait si longtemps un Dieu de colère de l’Ancien Testament au Dieu d’amour du Nouveau» (p. 54) et plutôt insister sur «l’affirmation de la fidélité de Dieu à sa Parole » (p. 55).
Le chapitre suivant plaide en quelques pages pour une lecture chrétienne des Psaumes qui ne renonce pas à leur judéité. Si l’appropriation des Psaumes par les chrétiens est légitime, elle ne doit pas faire l’impasse sur leur origine juive. C’est ce qu’on risque, selon J. Cuche, en omettant dans les psautiers chrétiens les versets qui introduisent une majorité de Psaumes.
Le troisième chapitre de cette partie est une «lecture dialogale» approfondie de la parabole du Fils prodigue (Luc 15, 11-32). J. Cuche propose d’abord un commentaire suivi du texte, dans lequel elle porte une grande attention au vocabulaire grec et à son substrat hébreu. Ceci permet des associations avec d’autres récits bibliques dont l’interprétation juive ou chrétienne éclaire certains aspects du récit: la rivalité des deux frères, le respect du père envers la liberté du fils cadet, son immense miséricorde et son espoir que l’aîné dépasse, lui aussi, la stricte justice. Elle suggère ensuite une lecture positive de la figure du fils aîné, dont trois caractéristiques, l’aînesse, le service et la fidélité, s’apparentent aussi bien à la figure d’Israël qu’à celle de Jésus. Les relations entre juifs et chrétiens peuvent être comparées à celles d’un aîné et d’un cadet, comme l’a fait Jean-Paul II. Le père leur témoigne un égal amour, qui ne nie pas les différences. «Ainsi en est-il des juifs et des chrétiens, commente J. Cuche, chacun ayant son cheminement propre bien que la direction soit la même: servir le Père» (p. 88). Elle note en terminant que la parabole ne raconte pas la rencontre entre les deux fils. On peut y voir une invitation à «laisser entre les mains du Père la rencontre finale des juifs et des chrétiens» (p. 90).
Viennent ensuite «Quelques réflexions sur le ‘faux-pas’ des juif dans les chapitres 9 à 11 de l’Épitre au Romains de saint Paul». L’intention de ces réflexions est d’attirer l’attention sur quelques vérités de ce texte qui n’ont pas encore «fait leur chemin dans l’esprit du peuple chrétien» (p. 91). En préalable, J. Cuche que le «refus» opposé par les juifs à l’Évangile doit être nuancé, puisque ce sont bien des juifs qui les premiers, ont dit «oui» au Christ et ont annoncé l’Évangile (p. 92). Elle rappelle ensuite que les accusations de Paul envers les juifs qui n’ont pas foi en Jésus sont similaires à celles que formulent Moïse ou les prophètes envers Israël. Pour Paul comme pour Moïse et les prophètes, Israël n’en reste pas moins «le peuple aimé de Dieu». Paul voit dans le refus d’Israël et sa mise à l’écart provisoire une mystérieuse stratégie divine pour attirer à lui les nations. Leur accès au salut devrait en retour susciter non pas la jalousie, mais plutôt comme l’a compris la Vulgate, une émulation réciproque dans le service de Dieu (Romains 11, 11-14). «N’est ce pas ce que nous constatons de nos jours, note J. Cuche, dans les groupes où juifs et chrétiens, dans le respect de leur différence, comprennent grâce à leur rencontre et à l’approfondissement de leurs liens, combien leur vocation de témoin en est stimulée (…) » (p. 103).
Cette deuxième partie se termine par une très courte méditation intitulée «La spiritualité de l’alphabet hébreu: Des lettres qui parlent de Dieu… ». Rapportant et commentant une légende juive à propos de l’alphabet hébreu, J. Cuche y évoque avec admiration la diversité et la richesse des lectures juives du texte biblique où tout peut faire sens et révéler la présence discrète de Dieu.
III. Transmettre
La troisième regroupe cinq textes où l’auteure, soucieuse de transmettre sa riche expérience, partage ses réflexions sur les défis de la réconciliation entre juifs et chrétiens, l’appréciation positive de leurs différences, les bénéfices pour les chrétiens d’une rencontre avec le judaïsme, l’utilité des dogmes dans le dialogue et à la fécondité du «non» juif à Jésus.
Un premier chapitre explore «la difficile construction de l’amitié entre juifs et chrétiens». Religions «issues et nées quasiment en même temps d’une unique source, le judaïsme biblique» (p. 113), le christianisme et le judaïsme rabbinique ont d’abord eu du mal à se distinguer clairement jusqu’à que l’entrée massive des païens les amène à s’opposer pour se distinguer. Ainsi sont nés la théologie chrétienne de la substitution et un antijudaïsme chrétien qui s’est aggravé d’antisémitisme au fil des siècles. Les chrétiens doivent garder le souvenir de ces fautes passées pour comprendre la réaction des juifs, qui, eux, ne les oublient pas. J. Cuche passe ensuite en revue sommairement les grandes étapes de la transformation des relations entre juifs depuis les efforts du précurseur que fut Charles Péguy et ceux de l’historien Jules Isaac jusqu’aux récentes déclarations juives et chrétiennes de 2015 soulignant les cinquante ans de la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II (1965). Elle identifie ensuite cinq défis contemporains: l’antijudaïsme qui persiste encore chez des chrétiens sous la forme d’une «vision négative ou dévalorisante du judaïsme» (p. 122); le défi théologique de concilier la valeur permanente de la Première Alliance et l’affirmation de l’Église que le Christ est l’unique rédempteur; le fléau toujours actuel de l’antisémitisme contre lequel les chrétiens doivent se mobiliser; l’antisionisme exacerbé par le conflit israélo-palestinien; et, finalement le défi de construire un partenariat entre juifs et chrétien autour de la mission commune de faire advenir le règne de Dieu et d’être ensemble «bénédiction pour le monde», selon le souhait de Jean-Paul II (p. 126).
Dans le court chapitre qui suit, «‘En Merkaba’ ou le voyage du dialogue judéo-chrétien», J. Cuche invite à réfléchir sur l’étrange vision du char céleste (Merkaba) décrit au premier chapitre du livre d’Ézéchiel. Ce char est conduit par quatre êtres fantastiques, tourné chacun dans une direction différente et allant droit devant soi. On en retrouve l’écho au chapitre 4 de l’Apocalypse, où ils encadrent le trône céleste et chantent les louanges du Très Haut. Lu comme une allégorie de ce à quoi sont appelés juifs et chrétiens, l’invitation à voyager en Merkaba, est une invitation à faire un voyage commun qui permettrait à chacun «de découvrir l’autre tout en avançant dans sa propre direction» (p. 113) et d’arriver tous au même lieu, la Maison du Père (p. 114).
J. Cuche expose ensuite, en six points, «Ce qu’apporte à un chrétien la rencontre avec le judaïsme». C’est une école d’humilité, où le chrétien doit d’abord écouter tout ce que contient la mémoire que les juifs ont gardé des tumultueuses relations passées. Le dialogue apprend aussi au chrétien la gratitude envers Israël pour tout l’apport de la tradition juive au christianisme. Une meilleure connaissance de cette tradition aide à mieux comprendre le Nouveau Testament. Le dialogue amène l’Église à renouveler la recherche théologique sur des thèmes essentiels comme la signification de la Nouvelle Alliance par rapport à la Première, jamais révoquée, etc. Si la découverte de la beauté du judaïsme invite le chrétien à l’émerveillement, elle le pousse aussi à approfondir sa propre foi. Pour que le dialogue soit fécond et vrai, poursuit J. Cuche, il faut aussi être capable «de parler ensemble de ce qui nous sépare, y compris les questions les plus difficiles» (p. 142). Elle termine en exhortant les chrétiens à partager, dans leurs Églises et autour d’eux, «la bonne nouvelle de la réconciliation, de cette fraternité possible, retrouvée après tant de siècles de séparation» (p. 144).
Le chapitre suivant s’intitule «De l’utilité des dogmes dans le dialogue judéo-chrétien. Une parole catholique ». J. Cuche y donne d’abord sa propre définition du dogme, inspirée de Charles Péguy et du Catéchisme de l’Église catholique (1992): «Une fenêtre qui ouvre sur un aspect du mystère de Dieu» (p. 148). Accueilli dans l’humilité, le dogme n’en sollicite pas moins l’intelligence et demande un effort de compréhension. Il est un motif de séparation entre juifs et chrétiens, puisqu’il marque leurs différences, sans être un obstacle au dialogue. Il peut même être un motif de rapprochement comme le montre par exemple l’analyse des dogmes chrétiens de l’Incarnation, la Résurrection et la Rédemption par l’universitaire juif Michael S. Kogan. Son étude l’amène à conclure que «tout ce qui fonde la foi chrétienne se trouvait à l’état de germe dans le judaïsme du temps de Jésus (…) ou du moins existait dans une interprétation possible de cette Tradition» (p. 157).
Le dernier chapitre de cette partie revient sur «Le Non juif à Jésus le Christ», déjà évoqué dans le chapitre sur «le ‘faux pas’ des juifs» selon Romains 9–11. J. Cuche y voit une double fécondité. Pour les juifs, ce Non est un signe de leur fidélité à la Première Alliance et à la Torah; il est aussi un signe de leur fidélité à la mission d’Israël d’être «lumière des Nations» en témoignant du Dieu unique. Replacé dans une perspective historique, leur Non est davantage un Non «au Jésus des chrétiens bien plus encore qu’à Jésus lui-même» (p. 166). Ce constat oblige l’Église à un regard critique sur son passé et à une purification de sa mémoire. Le Non juif «s’accompagne d’une affirmation inébranlable de la transcendance de Dieu» (p. 167), un aspect que les chrétiens risquent de négliger s’ils sont trop exclusivement centrés sur le Christ. Un des motifs du Non des juifs au Christ Sauveur est que «le monde qui s’offre à notre regard n’est pas sauvé» (p. 168). Cela rappelle aux chrétiens que ce monde qu’ils croient «sauvé en espérance, doit encore l’être chaque jour», avec la participation des hommes (p. 169), une tâche à laquelle ils peuvent collaborer particulièrement avec les juifs. Enfin, comme on l’a déjà vu, le Non juif peut être un stimulant pour la théologie chrétienne.
IV. Charles Péguy, source trop oubliée du dialogue judéo-chrétien
Les deux chapitres de cette dernière partie veulent «réparer l’oubli dans lequel sombre si souvent Charles Péguy lorsqu’on relate l’évolution des relations entre juifs et chrétiens» (p. 176).
Dans le premier, «Charles Péguy et les juifs, un modèle pour notre temps», J. Cuche s’intéresse particulièrement aux relations de Péguy (1873-1914) avec des juifs de son entourage, dont la fréquentation «le prémunit à jamais contre le poison antisémite» (p. 177). C’est, estime-t-elle, le contact personnel et quotidien avec des juifs «qui lui permit d’accéder à une connaissance, à une compréhension, sans doute uniques en son temps du judaïsme, du peuple juif et de sa mémoire» (p. 178). Péguy combattit vigoureusement l’antisémitisme et les préjugés sur lesquels il est fondé, particulièrement lors de l’affaire Dreyfus, dont il se fit un ardent défenseur. Comme chrétien, il s’est insurgé avec force contre l’accusation de déicide et a compris bien avant Nostra Aetate, la judaïté de Jésus et l’immense patrimoine spirituel commun aux juifs et aux chrétiens. Péguy, dont le message reste toujours actuel, peut être «une lumière pour nous montrer la route lorsque nous voulons, juifs et chrétiens, nous rencontrer en vérité» (p. 184).
Le second chapitre présente Péguy comme un «prophète de l’espérance». C’est dans la longue méditation Le Porche du mystère de la deuxième vertu que Péguy exprime sa «compréhension admirable, et étonnante pour son temps, de qu’est l’amour de Dieu pour ses créatures» (p. 186). Il y donne la parole à un Dieu «dont l’amour pour ses enfants, depuis la Création, est la joie et le tourment» (p. 188), un Dieu qui «espère en l’homme plus encore que l’homme n’espère en lui» (p. 190).
En conclusion de ce parcours, J. Cuche réitère sa conviction que juifs et chrétiens sont appelés à «être des hommes et des femmes de bénédiction, donc à apporter autour de nous consolation (…) et réconciliation», tout en attirant l’attention sur deux écueils à éviter, l’impatience et la recherche de l’unité à tout prix (p. 193). Elle s’en explique en faisant appel à deux passages bibliques. En Genèse 33, suite à leur réconciliation, Jacob préfère tout de même «prendre un chemin différent de celui de son frère Ésaü: «Il est bon de nous inspirer de la sagesse de Jacob et (…) de savoir, en restant fidèles à ce que nous sommes, avancer sur des chemins de foi proches et distincts», commente J. Cuche (p. 194). De même, dans l’Évangile de Jean (21, 21), lorsque Pierre demande à Jésus ce qu’il adviendra de Jean, Jésus n’offre qu’une réponse vague («Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe?») avant de lui demander de le suivre. On peut y lire une invitation aux chrétiens à marcher aux côtés des juifs sans prosélytisme et sans porter sur eux un jugement qui ne revient qu’à Dieu (voir p. 195).
L’ouvrage est complété par une liste de ressources («Pour aller plus loin», p 197-199) et un index des noms d’auteurs (p. 201-203).
* * *
On sera reconnaissant à J. Cuche d’avoir rassemblé ces textes où s’exprime avec clarté et conviction l’essentiel de sa longue et riche expérience de dialogue entre juifs et chrétiens. Au fil de la lecture de ces écrits diversifiés et contextualisés rédigés à plusieurs années de distance, apparaissent des thèmes centraux, répétés à quelques occasions et sous diverses formes: l’identification du patrimoine spirituel que les chrétiens ont reçu des juifs, l’importance de la rencontre avec le judaïsme d’aujourd’hui, la réconciliation et la collaboration entre juifs et chrétiens dans le respect de leurs différences, les défis théologiques posés à l’Église par sa nouvelle compréhension du judaïsme, etc. Loin d’être redondantes, ces reprises font état au contraire d’une pensée qui s’est développée et approfondie avec une remarquable cohérence en cours de route. On pourrait souhaiter ici et là une exploration plus fouillée de certaines thématiques (notamment sur la lecture juive et chrétienne des Psaumes), mais on y trouve déjà ample matière à réflexion. On ne peut qu’espérer une large diffusion, une lecture attentive et une appropriation de cet ouvrage dans les milieux de dialogue judéo-chrétien.